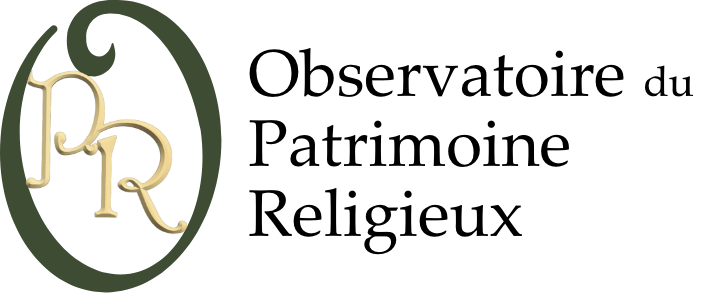Au premier semestre 2025, la France a recensé 322 actes antichrétiens, soit +13 % par rapport à la même période de 2024.
Les vols d’objets liturgiques ont bondi de 22,8 %, atteignant 820 cas en 2024 — soit cinq vols chaque semaine en moyenne.
Plus alarmant encore, les incendies criminels ont augmenté de 112,5 % entre 2023 et 2024. (chiffres de l Observatoire du Patrimoine Religieux).
Derrière ces chiffres, ce sont des lieux de prière, des œuvres d’art, des vitraux et des mémoires locales qui disparaissent dans l’indifférence générale.
La France, pourtant terre de patrimoine, voit se multiplier les dégradations d’églises souvent laissées sans surveillance ni moyens de protection adaptés.
Un phénomène Européen
La France n’est pas isolée : selon l’Observatory on Intolerance and Discrimination Against Christians in Europe (OIDAC), 2 444 actes antichrétiens ont été recensés en 2023 dans 35 pays européens.
En Allemagne, plus de 2 000 cas de dommages matériels ont été enregistrés sur des lieux de culte la même année, et les « crimes de haine anti-chrétiens » y ont augmenté de plus de 20 % en 2024.
Au Royaume-Uni, plus de 9 000 infractions (vols, vandalisme, incendies) ont touché des églises entre 2022 et 2024.
L’Italie, l’Espagne, la Pologne ou encore la Belgique ne sont pas épargnées.
Mais la comparaison ne s’arrête pas aux chiffres : elle révèle aussi de profondes inégalités dans les moyens de financement et de protection.
En France, la loi de 1905 rend les collectivités propriétaires des édifices religieux antérieurs à cette date : leur entretien dépend donc largement des communes, souvent démunies.
Ailleurs en Europe, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne, les Églises elles-mêmes assurent une part importante du financement, parfois soutenues par des fonds dédiés ou des assurances mutualisées, ce qui facilite la mise en œuvre de dispositifs de sécurité modernes.
La technologie face au Patrimoine
Face à la recrudescence des vols et du vandalisme, plusieurs pays européens ont amorcé un virage technologique :
- Vidéosurveillance intelligente : en Allemagne, la cathédrale d’Aix-la-Chapelle (Aachen) a installé un système vidéo à intelligence artificielle capable de détecter automatiquement fumées, intrusions ou mouvements anormaux et d’alerter pompiers et sécurité en temps réel.
- Robotique et capteurs autonomes : certaines églises expérimentent des drones d’intérieur ou robots de patrouille nocturne pour surveiller les nefs et cloîtres hors horaires d’ouverture.
- Analyse prédictive : l’IA peut aussi croiser les données d’accès, d’horaires et de flux de visiteurs pour identifier les périodes les plus risquées.
- Applications et serrures connectées : en France, la Fondation du Patrimoine a lancé le dispositif Sésame, une application qui permet d’ouvrir certaines églises fermées grâce à un code éphémère et sécurisé.
Ce système, déjà expérimenté en Bourgogne-Franche-Comté, combine accessibilité et traçabilité des visites, limitant ainsi les risques d’intrusion anonyme.
Ces innovations offrent des solutions pragmatiques : elles allègent la charge humaine, permettent d’agir en temps réel et créent un lien nouveau entre patrimoine, numérique et sécurité.
Des moyens inégaux, un devoir commun
Toutefois, l’accès à ces technologies reste profondément inégal.
Une paroisse rurale française n’a ni les budgets ni les équipes d’un grand diocèse allemand ou d’une paroisse anglaise soutenue par des fonds communautaires.
L’installation de caméras intelligentes, d’alarmes connectées ou de robots de surveillance suppose un investissement initial conséquent, souvent hors de portée pour des communes de quelques centaines d’habitants.
C’est pourquoi un plan national de sécurisation du patrimoine religieux, financé conjointement par l’État, les collectivités et les fondations privées, apparaît aujourd’hui indispensable.
Préserver pour transmettre
Protéger les églises, c’est préserver un héritage commun.
Chaque porte fracturée, chaque statue brisée, chaque incendie criminel est une atteinte à l’histoire de nos villes et villages.
La technologie — qu’elle soit numérique, robotique ou connectée — ne remplacera jamais la vigilance humaine, mais elle peut devenir un allié précieux pour ceux qui veillent sur ces lieux de silence et de beauté.
Protéger nos églises, c’est protéger notre mémoire collective et notre humanité commune.
Claire Danieli-Observatoire du Patrimoine Religieux-27 octobre 2025